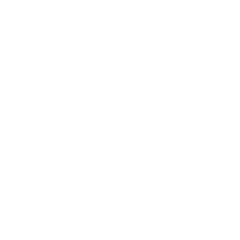La FOPES vient de fêter en ce mois de mai ses 50 printemps. Un demi-siècle pour un dispositif particulier dans le champ universitaire: une faculté ouverte de politique économique et sociale qui propose un master interdisciplinaire, en horaire décalé, à des adultes en reprise d’études. La FOPES, articulée à la fois sur le mouvement ouvrier et sur l’université, permet à des personnes d’accéder à l’université et d’enraciner leurs expériences de terrain et de vie dans un cadre théorique. Entretien avec Donatienne DESMETTE Professeure de psychologie sociale et du travail et présidente de la FOPES.
La FOPES vient de fêter en ce mois de mai ses 50 printemps. Un demi-siècle pour un dispositif particulier dans le champ universitaire: une faculté ouverte de politique économique et sociale qui propose un master interdisciplinaire, en horaire décalé, à des adultes en reprise d’études. La FOPES, articulée à la fois sur le mouvement ouvrier et sur l’université, permet à des personnes d’accéder à l’université et d’enraciner leurs expériences de terrain et de vie dans un cadre théorique. Entretien avec Donatienne DESMETTE Professeure de psychologie sociale et du travail et présidente de la FOPES.
 Le 16 février 1974, la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES) ouvre un premier cycle de deux ans, avec 99 étudiant·es répartis en quatre groupes (Namur, Louvain-laNeuve, Charleroi, Bruxelles), 20 enseignant·es, trois animateur·rices. Le 6 avril 1974, Monseigneur Massaux, recteur de l’Université catholique de Louvain (UCL), inaugure officiellement cette faculté très particulière pour une période expérimentale de trois ans. En 1977, l’essai étant concluant, la FOPES s’installe de manière durable dans le paysage universitaire. Fruit d’une volonté conjointe du MOC et de l’UCL, elle est aussi l’héritière de l’expérience de l’ISCO1.
Le 16 février 1974, la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES) ouvre un premier cycle de deux ans, avec 99 étudiant·es répartis en quatre groupes (Namur, Louvain-laNeuve, Charleroi, Bruxelles), 20 enseignant·es, trois animateur·rices. Le 6 avril 1974, Monseigneur Massaux, recteur de l’Université catholique de Louvain (UCL), inaugure officiellement cette faculté très particulière pour une période expérimentale de trois ans. En 1977, l’essai étant concluant, la FOPES s’installe de manière durable dans le paysage universitaire. Fruit d’une volonté conjointe du MOC et de l’UCL, elle est aussi l’héritière de l’expérience de l’ISCO1.
 Dans la vie sociale, les rapports entre les humains 1–mais aussi avec les animaux, l’environnement et le non humain2–prennent sens au travers de la culture. Ces relations sont structurées, interprétées et jugées comme légitimes 3 ou non grâce aux valeurs, aux récits, aux significations que la culture porte. Mais comment la culture et les systèmes symboliques agissent-ils dans la vie sociale et politique4 ? Nous identifions sept modes d’action différents. Nous en présentons ici les trois premiers; les suivants feront l’objet d’un article à paraitre5 .
Dans la vie sociale, les rapports entre les humains 1–mais aussi avec les animaux, l’environnement et le non humain2–prennent sens au travers de la culture. Ces relations sont structurées, interprétées et jugées comme légitimes 3 ou non grâce aux valeurs, aux récits, aux significations que la culture porte. Mais comment la culture et les systèmes symboliques agissent-ils dans la vie sociale et politique4 ? Nous identifions sept modes d’action différents. Nous en présentons ici les trois premiers; les suivants feront l’objet d’un article à paraitre5 .
 Les Déclarations de politique régionale et communautaire promulguent «l’interdiction de dévoyer de l’argent public dans la promotion de partis politiques», voire du militantisme associatif. En évoquant l’utilisation de l’argent public par les partis eux-mêmes et des exemples de dévoiement qui ne sont pas d’office poursuivis, nous sommes amené à reformuler cette question du rapport qu’entretiennent les associations d’éducation permanente avec le militantisme en évoquant l’utilisation d’argent public à d’autres fins que les missions décrétales définies par les pouvoirs publics et acceptées par les associations agréées1.
Les Déclarations de politique régionale et communautaire promulguent «l’interdiction de dévoyer de l’argent public dans la promotion de partis politiques», voire du militantisme associatif. En évoquant l’utilisation de l’argent public par les partis eux-mêmes et des exemples de dévoiement qui ne sont pas d’office poursuivis, nous sommes amené à reformuler cette question du rapport qu’entretiennent les associations d’éducation permanente avec le militantisme en évoquant l’utilisation d’argent public à d’autres fins que les missions décrétales définies par les pouvoirs publics et acceptées par les associations agréées1.
(c) Bénédicte Moyersoen, projet "Tissons des liens, pas des menottes"